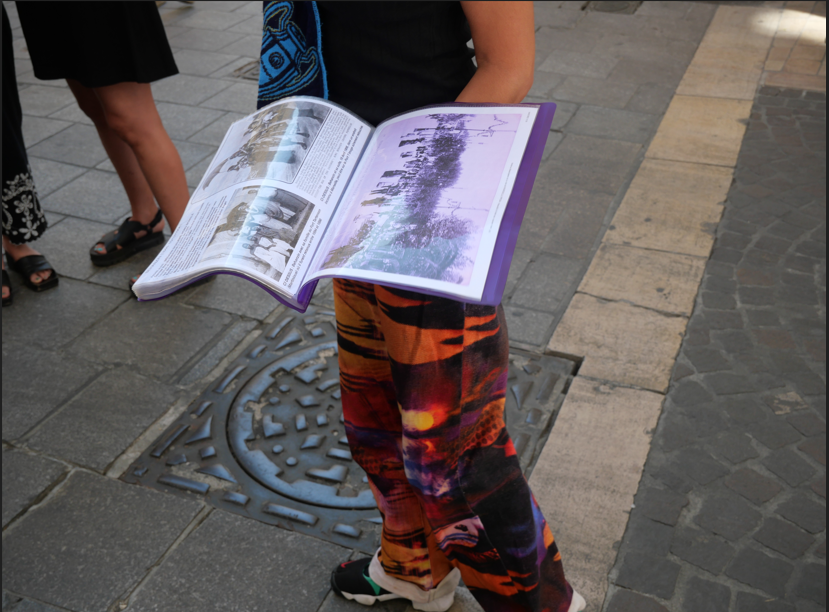Solidarite internationale
Comprendre le passé colonial de la cité phocéenne

Dans le cadre du projet Tae’Thir*, nous avons eu l’occasion de rencontrer Mariam Benbakkar, cofondatrice du collectif Filles de Blédards, avec lequel elle organise régulièrement des événements avec des artistes émergents. L’objectif de ce collectif est de déconstruire l’imaginaire postcolonial en France. Depuis une dizaine d’années, elle se plonge dans les archives de la ville marseillaise afin de proposer des visites autour de son passé colonial.
Ce mercredi 9 juillet, nous nous sommes donnés rendez-vous rue Saint-Ferréol pour découvrir avec elle l’histoire de certains monuments marseillais. Les participants du cycle 2 du projet tae’thir ont passé une semaine à Marseille (du 03 au 09 juillet 2025). Lors de cette semaine d’ateliers, deux journées ont été dédiées à la rencontre des acteurs locaux. Ce tour organisé par Mariam Benbakkar est une des cinq rencontres organisées.
* Le projet Tae’Thir, signifiant « influence » en arabe, vise à promouvoir la culture des droits humains dans la région méditerranéenne à travers les pratiques numériques et artistiques de plusieurs participant·es. D'une durée de trois ans, le projet est porté par Réseau Euromed France (REF), le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), les Instants vidéo numériques et poétiques et la Ligue de l'enseignement des Bouches-du-Rhône. Il bénéficie du soutien financier de l’Agence française de développement (AFD) de la Délégation interministérielle à la Méditerranée (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) ainsi que de la Fondation de France.
Marseille du XVIIIe siècle à nos jours
Massilia, une cité stratégique
Marseille, en raison de sa situation géographique, représente un enjeu majeur pour l’économie française sous le Second Empire. À la suite de la construction du canal de Suez en 1854, l’État français convoite l’exploitation de cet axe stratégique pour y exporter de nombreuses denrées égyptiennes, mais aussi pour étendre son impérialisme sur les continents africain et asiatique, de la fin du XVIIIe jusqu’au XXe siècle. Le port de Marseille devient alors une infrastructure essentielle.
Pour faire croître l’économie française, la construction de banques et d’institutions était primordiale. Parmi les beaux édifices de la rue Saint-Ferréol, on pouvait trouver des établissements bancaires tels que la Compagnie Algérienne, aujourd’hui un magasin Uniqlo, ou la Banca Commerciale Italiana, devenue un H&M. Au numéro 25, le bâtiment du Crédit Lyonnais, construit en 1875, remplit toujours sa fonction initiale.
Les banques mixtes des XVIIIe et XIXe siècles réunissaient capitaux publics et privés. Fonctionnant par actions, avec des investisseurs privés et le soutien de l’État, elles finançaient les grands travaux et l’industrie, promettant des rendements aux actionnaires. Leur rôle fut central dans l’essor économique de la France.
Sous Napoléon III, Marseille voit la construction d’une nouvelle préfecture, richement décorée à la gloire du Second Empire et des premières conquêtes coloniales. Nous nous sommes ensuite rendus devant la Chambre de commerce et d’industrie, située en bas de la Canebière, pour mieux comprendre sa fonction.
Expositions coloniales au Parc Chanot
La CCI (Chambre de commerce et d’industrie), fondée au XVIe siècle, est chargée de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services. Elle collabore avec les collectivités locales pour promouvoir leur développement économique et leur attractivité.
Mariam a pris le temps de nous décrire la fresque située sur la façade de l’établissement, sculptée à la gloire du gouvernement français, au mépris de l’occupation coloniale, avec des représentations caricaturales des peuples colonisés.
Au début du XXe siècle, un événement majeur vient renforcer les fonctions de la CCI : l’Exposition coloniale de Marseille en 1906, la troisième organisée en France. Cette manifestation vise à promouvoir les échanges commerciaux entre la métropole et ses colonies. En 1922, la ville organise une seconde exposition, sur le même site, au bout de l’avenue du Prado. Celle-ci accueille près de trois millions de visiteurs, notamment grâce à l’usage massif de la carte postale comme outil de communication et de propagande.
Mouvements de contestation contre la colonisation
Des discours anticoloniaux, souvent portés par des mouvements communistes, commencent à se structurer et à se diffuser dans les colonies et en France après la Première Guerre mondiale. À Marseille, pendant l’Exposition coloniale de 1922, plusieurs collectifs et associations voient le jour, souvent à l’initiative de personnes colonisées vivant en métropole.
Pendant les guerres d’Indochine et d’Algérie, la ville et son port deviennent des lieux centraux de mobilisation contre les guerres coloniales et en faveur des indépendances.
La découverte de vestiges dans la cité
Marseille est une ville bâtie sur des vagues migratoires successives. Située au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, elle occupe une position stratégique. Dans les années 1960, des politiques d’immigration de main-d’œuvre sont mises en place à l’échelle nationale puis locale. L’histoire de l’industrialisation prend alors une autre tournure : l’État comprend qu’il peut tirer profit de la main-d’œuvre étrangère et coloniale.
La population ouvrière représente alors la moitié de la population marseillaise, dont environ 25 % sont des travailleurs migrants. En 1967, lors des travaux de construction du Centre Bourse, un ouvrier découvre par hasard des vestiges. Refusant de poursuivre les travaux, il demande l’intervention d’archéologues. Ce sont 10 000 m² de vestiges qui sont finalement sauvegardés, révélant les remparts et le port antique de Marseille.
Le Centre Bourse est inauguré dix ans plus tard, en 1977. Après plus de dix ans de fouilles, le Musée d’Histoire de Marseille est créé en 1983, attenant au Jardin des Vestiges. Nous avons pu contempler ces jardins depuis la passerelle.
Marseille victime de gentrification
Pour clôturer la balade, nous avons remonté la Canebière et nous nous sommes arrêtés devant un hôtel du Second Empire : le Grand Hôtel Louvre et Paix, inauguré en 1863. Aujourd’hui, cet établissement est occupé par une boutique C&A. Sa façade luxueuse ne passe pas inaperçue. À l’origine, il abritait 20 salons, deux restaurants et 150 chambres, portées à 250 quelques années plus tard, réparties sur six étages.
En face, se trouve l’hôtel Mercure, avec au rez-de-chaussée la brasserie Le Capucin. Ce nouvel hôtel de luxe a ouvert ses portes en 2019. Auparavant, l’immeuble était laissé à l’abandon et servait de squat pour des personnes sans-abri. Il appartenait à des bailleurs privés avant d’être racheté par la chaîne Mercure.
Ce rachat a provoqué la polémique, car l’hôtel se situe juste en face du quartier populaire de Noailles. Pour rappel, deux immeubles s’étaient effondrés en 2018 rue d’Aubagne, causant la mort de huit personnes. L’événement avait révélé l’ampleur de la crise du logement à Marseille.
Dès son ouverture, de nombreux appels au boycott de l’hôtel ont été lancés, dénonçant la gentrification et le tourisme de masse, qui participent à l’exclusion des populations les plus précaires. Le face-à-face entre le C&A (ancien Grand Hôtel) et l’hôtel Mercure symbolise une histoire qui se répète : celle d’une ville qui accueille les plus aisés au détriment des communautés marginalisées.
Article rédigé par Judith.L, alternante au sein du service communication